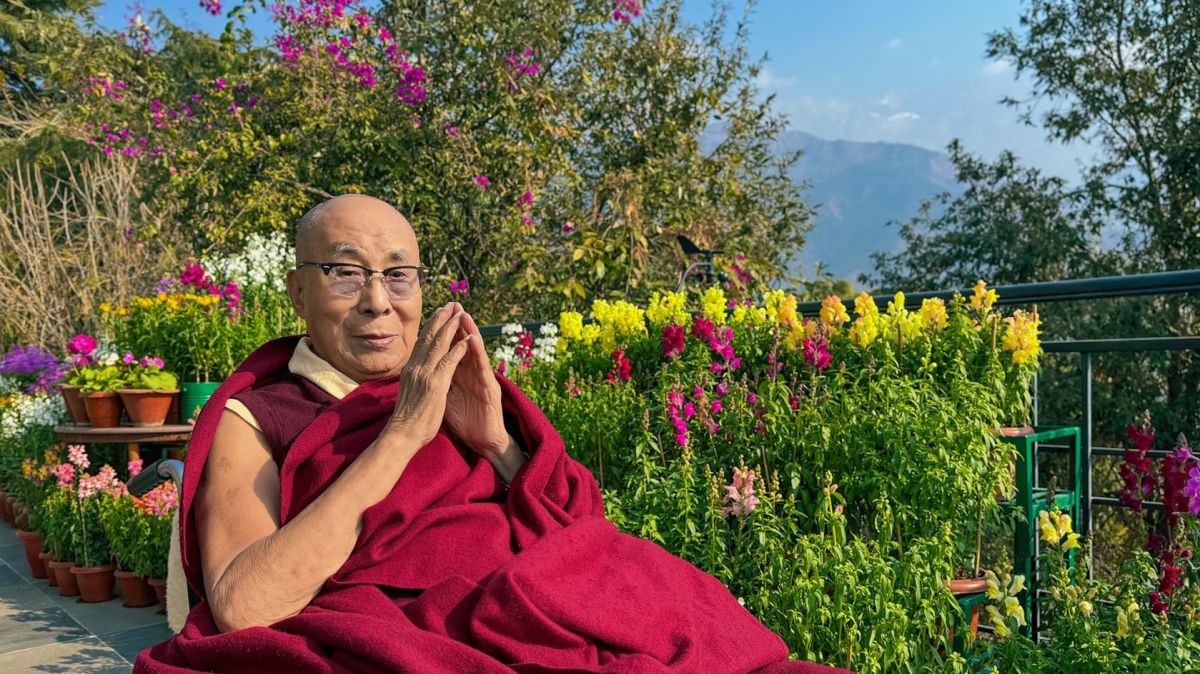Mais en essayant de protéger l'intégrité de ce processus, le Portugal pourrait finir par pénaliser les personnes mêmes qu'il prétend accueillir.
La nouvelle proposition ferait passer de cinq à dix ans l'obligation de résidence pour les demandes de nationalité pour la plupart des ressortissants non-CPLP - et elle s'appliquerait rétroactivement, même à ceux qui ont déjà plusieurs années de résidence légale. Bien qu'elle soit censée limiter les abus et restaurer la confiance, cette règle est si large qu'elle ne permet pas de distinguer la présence passive de la participation active.
En pratique, cela signifie que les professionnels, les entrepreneurs, les chercheurs et les retraités étrangers - des personnes qui parlent la langue, contribuent à l'économie, élèvent des familles et adoptent la culture portugaise comme la leur - seront désormais contraints d'attendre une décennie entière avant de demander la citoyenneté. Non pas parce qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer, mais parce qu'ils détiennent le mauvais passeport.
Ces résidents ne sont pas venus simplement pour vivre au Portugal, mais pour y appartenir. Rien que dans l'incubateur public de startups de Lisbonne, plus de 37 % des équipes fondatrices sont étrangères - et elles ont créé plus de 4 500 emplois qualifiés ces dernières années. Il ne s'agit pas d'exceptions isolées, mais de la preuve que l'intégration, lorsqu'elle est fondée sur le mérite et l'engagement, génère une valeur nationale visible.
Je suis l'un d'entre eux. Nous nous sommes installés au Portugal par choix et non par nécessité. Nous avons construit une entreprise, créé des emplois et pris des engagements à long terme en partant du principe que le cadre juridique était stable. Le changement de cap actuel envoie un mauvais message, non seulement aux résidents comme nous, mais aussi aux futurs investisseurs, employeurs et familles qui envisagent de suivre la même voie.
Il ne s'agit pas de privilèges ou de raccourcis. C'est une question d'équité. Une approche unique peut sembler impartiale sur le papier, mais elle gomme les différences réelles entre ceux qui s'intègrent profondément et ceux qui ne le font pas.
Il ne s'agit pas de favoriser la richesse ou l'éducation, mais la contribution et l'engagement. Un système équitable devrait faire la distinction entre les résidents qui investissent dans l'avenir du pays - économiquement, linguistiquement et culturellement - et ceux qui restent détachés de ses institutions, de sa langue ou de ses valeurs. Un système unique ignore totalement cette distinction.
Des pays comme les Pays-Bas et Singapour - à la fois sélectifs et stricts - parviennent à accélérer l'obtention de la citoyenneté pour les résidents qui démontrent leur intégration par la maîtrise de la langue, une contribution à long terme et une participation civique. Le Portugal peut faire de même sans compromettre ses normes.
Une solution simple consisterait à honorer le temps déjà accumulé - par exemple, 3,5 ans, soit ~70 % de l'exigence antérieure de cinq ans - à condition que le résident puisse faire la preuve d'une réelle intégration. Cela inclut la maîtrise du portugais, une résidence stable, une contribution fiscale, une compréhension des institutions civiques et un engagement clair envers le pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel.
Nombreux sont ceux qui ont recours à des soins de santé privés, qui ne pèsent pas sur les systèmes publics et qui ont choisi le Portugal pour investir dans leur avenir.
Récompenser ces formes d'appartenance n'est pas une dilution, c'est un alignement. Elle reflète le meilleur de ce que la citoyenneté portugaise devrait représenter : des valeurs partagées, un engagement mutuel et une confiance construite au fil du temps.
Changer les règles à mi-chemin risque d'éroder cette confiance. Le Portugal a encore le temps de rectifier le tir - et ce faisant, il prouverait plus que n'importe quel discours ne pourra jamais le faire.